Depuis le premier télescope construit par Galilée, les techniques ont beaucoup progressée. . Parmi les nombreuses évolutions techniques, un détail d’apparence anodine a révolutionné la qualité des observations : la forme du miroir principal. Les télescopes peu onéreux ont un miroir sphérique, mais si on monte en gamme, la tendance est au miroir épousant une forme parabolique (dont la forme suit une courbe de type y=ax²). Voyons pourquoi !
Le problème de l’aberration sphérique
Un miroir sphérique est simple à comprendre : il correspond à une portion d’une sphère parfaite. Sa fabrication est relativement aisée car la symétrie sphérique est naturelle dans les procédés de polissage.
Cependant, un miroir sphérique souffre d’un défaut majeur : l’aberration sphérique. Ce phénomène signifie que les rayons lumineux réfléchis par différentes zones du miroir ne convergent pas exactement au même point.
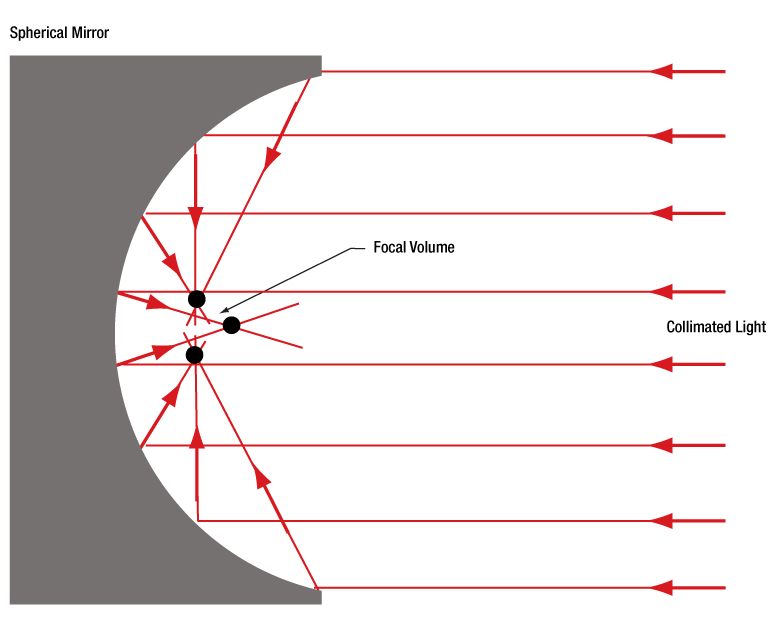
Résultat, l’image d’un objet situé à l’infini va apparaître flou. C’est un peu gênant en astronomie puisque les objets observés ne sont pas tout à fait à la porte à côté. Pour les miroirs à faible diamètre, cela ne va pas se voir, car le volume focal restera inférieur à la taille d’un pixel. Par contre, si on augmente la taille du miroir, le résultat risque de ne pas être au niveau attendu.
Le miroir parabolique
À l’inverse, un miroir parabolique est conçu de manière que tous les rayons parallèles à l’axe optique soient réfléchis vers un seul et unique foyer. C’est une propriété fondamentale de la parabole : chaque rayon incident parallèle est parfaitement focalisé. Le miroir parabolique garantit ainsi une image nette et précise, sans aberration sphérique.
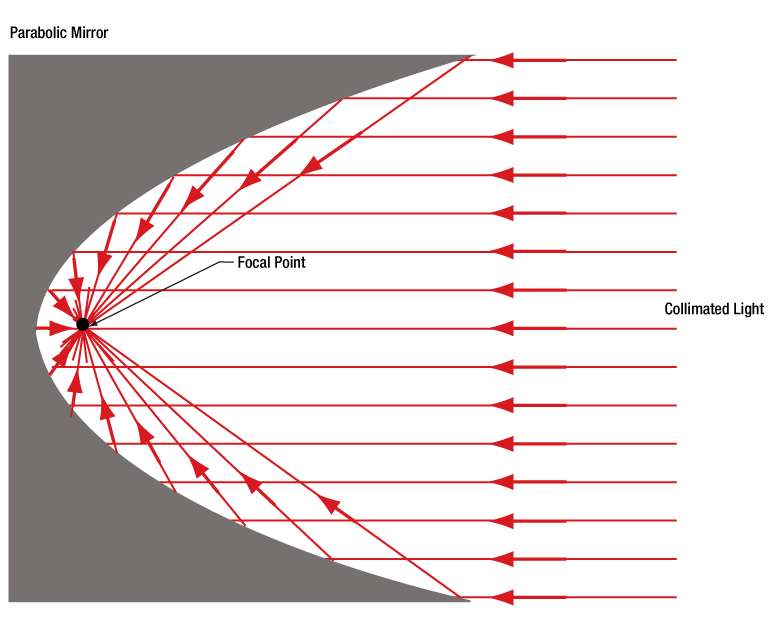
C’est pour cette raison que tous les grands télescopes, qu’ils soient amateurs avancés ou professionnels (comme le télescope spatial Hubble), utilisent des miroirs paraboliques ou quasi-paraboliques.
A partir de quel diamètre le miroir sphérique devient génant
La réponse n’est pas simple, car cela dépend aussi du rapport F/D du téléscope. Un miroir sphérique à F/D très élevé (par exemple F/10 ou F/15) peut tolérer l’aberration sphérique sur des diamètres un peu plus grands, car l’angle d’incidence des rayons est plus faible (donc l’aberration est moins marquée).
Un miroir sphérique à F/D faible (par exemple F/4, F/5), donc très ouvert, montre des aberrations beaucoup plus visibles même pour des petits diamètres.
En pratique, l’aberration sphérique devient gênante dès qu’on dépasse environ 100 mm à 150 mm de diamètre (donc 10 à 15 cm), si le miroir est sphérique et qu’on n’utilise pas de correcteur.
La correction du miroir sphérique
Il existe des systèmes qui corrigent l’aberration d’un miroir sphérique, comme dans les télescopes de type Schmidt-Cassegrain ou Maksutov-Cassegrain. Ces télescopes utilisent des plaques correctrices (placées à l’entrée du tube) pour compenser les défauts. Cela permet d’avoir un instrument compact et performant, mais au prix d’une complexité optique supplémentaire.
En revanche, pour les télescopes purement réfléchissants (de type Newton, par exemple), le miroir parabolique reste la solution la plus directe et efficace pour obtenir une excellente qualité d’image.
